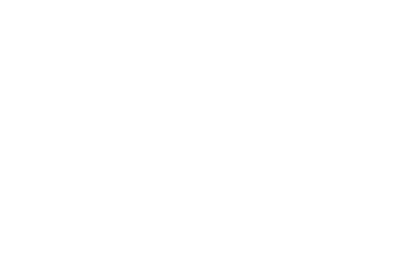Dimanche
Jean-Jacques Gailliard
décorateur.trice, dessinateur.trice, graveur.euse, illustrateur.trice, peintre, écrivain.e1890-1976
Matériaux
Inscriptions
"Jean-Jacques Gailliard"
(en bas à droite)
Dimensions
hauteur 100 cm — largeur 80 cm
Numéro d'inventaire
582029 / 4238 (C.F.)
Identifiant Urban
83670
Description
"Dimanche" est une oeuvre caractéristique du style de l'artiste, mais également de l'un de ses thèmes de prédilection, la représentation fantomatique des quartiers de Bruxelles. Jean-Jacques Gailliard (Bruxelles 1890 - St Gilles 1976), s'il a évolué d'un style impressionniste hérité à ses débuts de son père et premier maître, Franz Gailliard, peintre s'inscrivant dans un pointillisme luministe, vers un style personnel qualifié de surimpressionniste, en passant par une période symboliste puis une autre d'abstration lyrique, s'est défini lui-même sans relâche comme peintre swedenborgien, caractérisant de la sorte sa peinture par l'influence du mysticisme de Swedenborg, fondateur de l'Eglise de la Nouvelle Jerusalem, courant religieux imprégné d'ésotérisme auquel il avait adhéré dès 1912. En quoi le tableau intitulé "Dimanche" peut-il être qualifié de swedenborgien ? Cela n'apparait pas au premier coup d'oeil, comme souvent lorsqu'il s'agit de découvrir l'intention en art. Jean-Jacques Gailliard l'énonçait lui-même de son vivant : il ne serait pas simple de comprendre son rapport sacralisé à la peinture sans être initié à la pensée de Swedenborg, et peut-être à d'autres courants religieux, car il s'était également intéressé, notamment, au soufisme, au bouddhisme et à la kabbale. Il avait, par ailleurs, fourni une piste d'interprétation en affirmant sa tentative de peindre les 'correspondances" entre l'univers et le monde spirituel, faisant explicitement référence aux "universaux". Ce faisant, il s'inscrivait à sa façon dans les pas de Bertrand Russel, fondateur de la philosophie analytique, et de Wittgenstein, qui en approfondit les termes. Y étaient distinguées deux grandes classes de réalités : les particuliers (objets et sensations physiques) et les universaux (prédicats et relations), ces derniers correspondant sous des appellations contemporaines plus précises à l'ancienne "compréhension de ce qui est commun aux choses singulières". Est-il simpliste de voir dans la représentation fantomatique de ce quartier de Bruxelles et dans celle, plus fantomatique encore, simple silhouette, du personnage à l'avant-plan, penché méditativement sur une activité indéfinissable, la représentation abstraite de la notion de "dimanche", jour de paix extérieure et intérieure
Discussion



![Roue dentée en bois, modèle de fonderie (probablement réalisé à l'Ecole de dessin et de modelage de Molenbeek-Saint-Jean), s.d. [fin 19e siècle ?].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/O_2022_004_web_DSF0432.jpg)







![Carte-vue Carrefour Rue Albert Vanderkindere / Rue Gauthier [Rue Isidoor Teirlinck], café 'Au Sportman', éd. F. Walschaert (Bruxelles), s.d. [vers 1911].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/P_2020.001.jpg)




![Carte-vue colorisée Maison Communale et Place Communale avec marché, éd. Grand Bazar Anspach (Bruxelles), s.d. [vers 1908].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/SP_2010.0296.jpg)




![« Kaffkasche szene » [scène kafkaïenne]<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/118/12134.jpg)
![Notice Entreprise générale Louis De Waele, charpenteries et menuiseries, Boulevard Léopold II, 46 (Molenbeek-Saint-Jean), s.d. [1899], 2 feuilles<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/PAKA_2023.026.2_A.jpg)
![Photo Portrait d'un jeune enfant assis, photogr. Henri Becker (Molenbeek-Saint-Jean), s.d. [début 20e siècle].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/SF_2011.0289-.jpg)