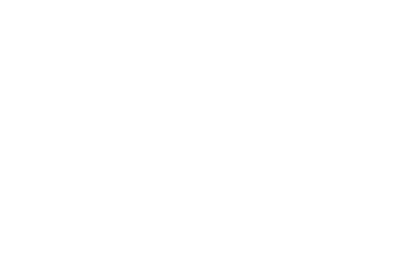Les comtes d'Egmont et de Hornes
Charles-Auguste Fraikin
Compagnie des Bronzes
Datation
Type d'objet
Matériaux
- métal > bronze (sculpture)
- matières minérales > pierre (architecture)
Techniques
Style
Inscriptions
Numéro d'inventaire
Identifiant Urban
Description
La statue des comtes d’Egmont et
de Hornes a été réalisée par le sculpteur et peintre belge Charles-Auguste
Fraikin, connu notamment pour la fontaine Rouppe. Sa sculpture d’Egmont et Hornes se trouvait de 1864 à 1877 sur la
Grand-Place de Bruxelles, devant la Maison du Roi. Elle fut retirée en 1877 en
raison de travaux de restauration de cet édifice. Les comtes ne restèrent que
peu de temps absents de l’espace public et furent transférés en 1879 à leur
emplacement actuel : la place du Petit Sablon.
Dès sa conception, l’œuvre
suscita la controverse. Le choix de Lamoral d’Egmont (1522-1568) et de Philippe
de Hornes(1524-1568) comme sujets de la statue fut déjà critiqué et discuté au
sein du conseil communal de Bruxelles. Certains débattaient de la dignité des
deux hommes, estimant qu’Egmont se serait mal comporté avant son exécution et
aurait même imploré pardon. Finalement, en 1859, il fut décidé que la statue
serait érigée non pour son exactitude historique, mais pour son approche
hagiographique contribuant au sentiment national.
En 1862, un critique du Journal
des beaux-arts put visiter le premier modèle dans l’atelier de Fraikin. Il
pardonna le manque de rigueur historique, comprenant qu’il ne s’agissait pas de
commémorer un événement historique mais de « glorifier l’indépendance belge ».
En 1864, le projet fut approuvé par la Commission royale des monuments et placé
devant la Maison du Roi, au lieu exact où les deux hommes furent décapités le 5
juin 1568 après avoir été condamnés par le duc d’Albe (1507-1582), le
gouverneur espagnol des Pays-Bas, réputé pour sa tyrannie, pour, entre autres,
lèse-majesté. Leur participation à la Ligue des nobles (1565), une association
d’aristocrates opposés à l’inquisition espagnole stricte, avait été perçue
comme une atteinte à l’autorité royale.
Les deux hommes sont représentés avec
un regard combatif, dans une sorte d’étreinte juste avant leur exécution. Leur
image repose sur un haut socle portant leurs armoiries et flanquée de deux
lansquenets. L'un était soldat de cavalerie légère, sous les ordres du comte
d'Egmont lors de la bataille de Gravelines (1558), l'autre soldat de cavalerie
lourde, sous les ordres du comte de Hoorn lors de la bataille de Saint-Quentin
(1557). Au centre, une inscription en français et en néerlandais était gravée :
« Aux Comtes d'Egmont et de
Hornes Condamnés par Sentence inique du duc d'Albe et Décapités à Bruxelles 5
juin 1568 »
« Aan de graven van Egmont en Hoorn,
onrechtvaardig veroordeeld door de Hertog van Alva en Onthoofd te Brussel de 5
juni 1568.»
Cette inscription fut elle-même
l’objet d’une petite polémique politique et linguistique. Fraikin avait demandé
à la ville de poser une inscription bilingue temporaire, ce qui fut
initialement accueilli favorablement pour souligner l’unité. Comme elle était
temporaire, une faute grammaticale dans le texte français fut tolérée. En 1865,
le conseil communal décida de remplacer l’inscription bilingue par un texte
latin, décision qui suscita une forte opposition flamande. Leur résistance fut
finalement couronnée de succès : l’inscription bilingue fut maintenue, avec
correction grammaticale du français.
Après l’installation de la statue
sur la place du Petit Sablon, Henri Beyaert (1823-1894), l’architecte de la
place, fit de cette œuvre le point central. Il plaça dix statues en marbre en
demi-cercle autour d’Egmont et Hornes, formant, avec les deux comtes, un « panthéon
» belge du XVIᵉ siècle dans l’esprit des autorités organisatrices du XIXᵉ
siècle, ancrant ainsi l’identité de la jeune nation dans l’histoire. En 1882,
quelques échevins critiquèrent cette disposition, estimant inacceptable que
Guillaume d’Orange (1533-1584) et Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde
(1540-1598) fussent subordonnés à Egmont et Hornes ou placés au même niveau que
des figures moins importantes. Ces protestations furent ignorées et
l’agencement fut conservé tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Toutes les statues de la fontaine
de la place du Petit Sablon furent restaurées en 1997 sous la direction de
l’architecte Barbara Van der Wee et avec le financement de la fondation
Cornelis Floris.
Sources
1964 Lesoir 05 02 : Louis
Robyns de Schneidauer
RENOY, G., Le Sablon, Rossel, Bruxelles 1982, p.59-71.
ASSOCIATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE A.S.B.L., Sablon, le quartier et l'église, coll. Bruxelles, Ville d’Art et d’Histoire, n°9,Région de Bruxelles-Capitale, 1994, p.39-47.
WASSEIGE, M., « Le Petit Sablon: une histoire de la nation », in Art et architecture publics, Région de Bruxelles-Capitale, 1999, p.103-108.
DEROM, P. (dir.), Les sculptures de Bruxelles, Galerie Patrick Derom, Pandora, 2000, p. 82-87.
DEROM, P., Les sculptures de Bruxelles. Catalogue raisonné, Patrick Derom Gallery, Brussels, 2002,, p. 47-55.
PIRON, P. Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe Siècles, Xavier Mellery, Editions art in Belgium, 2003, Tome 2 p.159.
BELIRIS, Restauration du Square du Petit Sablon- Restauratie van de Kleine Zavelsquare, 2014, https://www.beliris.be/projets/restauration-du-square-du-petit-sablon.html
Discussion

























![Photo Commerce de tapisserie et ameublement Van Hentenrijck-Peeters, Chaussée de Gand, 138 (Molenbeek-Saint-Jean), photogr. anon., s.d. [vers 1933].<br>](https://collections.heritage.brussels/medias/66/objects/77/P1_2022.089.jpg)